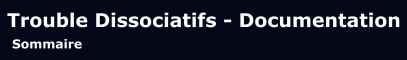Auteurs : Strouza, A. I., Lawrence, A. J., Vissia, E. M., Kakouris, A., Akan, A., Nijenhuis, E. R. S., Draijer, N., Chalavi, S., & Reinders, A. A. T. S.
Références : Strouza, A. I., Lawrence, A. J., Vissia, E. M., Kakouris, A., Akan, A., Nijenhuis, E. R. S., Draijer, N., Chalavi, S., & Reinders, A. A. T. S. (2023). Identity state-dependent self-relevance and emotional intensity ratings of words in dissociative identity disorder: A controlled longitudinal study. Brain and Behavior, 13, e3208.
https://doi.org/10.1002/brb3.3208
Introduction
L’introduction de l’article commence par rappeler ce qu’est le trouble dissociatif de l’identité (TDI). Une des caractéristiques essentielles du TDI est que la mémoire et le sens de soi sont discontinus. Néanmoins, les auteurs relèvent un manque d’études longitudinales sur ces discontinuités. Dans le passé, les autres études utilisaient des mots avec des poids émotionnels plutôt neutres au lieu d’utiliser des mots liés à des sujets spécifiques ou aux traumas. D’où l’étude de l’article qui cherche à explorer ces aspects.
Deux familles d’états identitaires ont été conceptualisées : les états identitaires liées aux traumas (EIT) et les états identitaires neutres (EIN). Chaque état identitaire influence les souvenirs autobiographiques auxquels la personne va avoir accès à un moment donné. Les EIN sont liés à la vie « normale » et fonctionnelle, et ont peu voire pas accès aux souvenirs de traumas. Les EIT ont souvent un comportement et un âge subjectif infantiles, ne sont pas au contact de l’ici et maintenant et sont submergés par les souvenirs et expériences traumatiques.
La plupart des études précédentes qui se penchaient sur la mémoire dans le TDI se focalisaient sur le transfert inter-identités des connaissances qui ne sont pas autobiographiques ; quelques études se penchaient sur les indices faisant référence au soi, mais aucune ne s’est penchée sur la continuité de la manière dont les différentes identités entrent en relation avec des mots.
L’étude présente va se pencher sur la façon dont différentes identités vont évaluer des mots en fonction de leur rapport au sens du soi et de l’intensité émotionnelle.
Méthodes
Trois types de mots sont testés : des mots faisant référence à des traumas propre à la personne, des mots faisant référence à des traumas qui ne sont pas propres à la personne et des mots neutres qui ne font pas référence à la personne. Deux sessions sont organisées à plusieurs semaines d’intervalle.
Le groupe étudié est diagnostiqué avec TDI, les deux groupes contrôle n’ont pas de TDI. Le premier groupe contrôle va imiter le TDI et l’autre groupe contrôle est composé moitié de personnes sans trouble et moitié de personnes avec un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT).
L’hypothèse de base est que l’évaluation sera similaire d’un groupe à l’autre et d’un moment à l’autre. On suppose que les mots faisant référence à soi seront notés plus intensément, que les mots faisant référence aux traumas seront notés plus intensément, mais que les réponses seront différentes et que le groupe diagnostiqué TDI aura une réaction plus intense que les groupes contrôles.
Participants
Les participants TDI ont été diagnostiqués avec l’édition néerlandaise de l’Entretien Clinique Structuré pour les troubles dissociatifs décrits dans le DSM-IV. Ils ont été sélectionnés pour leur capacité à switcher clairement et avec assez de contrôle entre leurs états identitaires neutres et leurs états identitaires traumatisés.
Les participants simulant le TDI étaient des acteurs et actrices avec un minimum de 2 ans d’expérience et ne présentant aucun diagnostic de trouble mental, ni aucune prise de médicament psychotrope par le passé. On leur demandait de simuler un TDI avec une identité neutre et une identité traumatisée.
En partant du constat que le TDI et le TSPT sont tous les deux causés par des traumatismes, une partie du troisième groupe contrôle était composée de personnes diagnostiquées TSPT pour pouvoir être comparée aux EIT du groupe TDI. L’autre partie était composée de personnes sans aucun trouble afin d’être comparée aux EIN du groupe TDI. On leur disait qu’on étudiait les réponses aux souvenirs autobiographiques, mais pas qu’ils allaient être comparés avec des personnes TDI.
Au total il y avait 46 participantes : 13 TDI, 11 actrices, 11 personnes sans aucun trouble et 11 TSPT. Tous les participantes étaient des femmes de 18 à 65 ans. On notera qu’une étude a montré que les hommes et les femmes sans troubles mentaux réagissent différemment aux souvenirs autobiographiques, en fonction de leur genre.
Procédure
Deux sessions ont été organisées. Durant la première session, une liste de 278 mots a été donnée aux participantes pour être évaluée en termes d’intensité de relation à soi et d’intensité de la réponse émotionnelle, spécifiquement la réponse émotionnelle négative. Les participantes devaient donner une note en s’auto-évaluant. La deuxième session sélectionnait, par personne, uniquement les mots qui avaient reçu les notes les plus basses et les plus hautes durant la première session. La même évaluation était alors demandée.
Les deux sessions se déroulaient à 6 semaines d’intervalle.
Matériel
La liste des mots donnés durant la première session est disponible dans les appendices de l’article de base. Pour la deuxième session, 60 mots étaient sélectionnés : les 20 mots notés les plus bas en émotion et en autobiographie, 20 mots notés bas en autobiographie et hauts en émotions et les 20 mots notés les plus hauts à la fois en émotions et en autobiographie.
Trois échelles d’évaluation de la dissociation ont été utilisées : la Cambridge Depersonalization Scale (CDS), la Dissociative Experiences Scale (DES) et la Somatoform Dissociation Questionaire (SDQ-20).
Analyses statistiques
Un logiciel a été utilisé pour calculer, par participante et par état identitaire, la moyenne de l’intensité émotionnelle négative et la moyenne de l’intensité autobiographique de chacune des trois catégories de mots. Les niveaux de dissociation ont aussi été analysés statistiquement.
Le but était de voir si les mots censés faire référence à soi étaient bien notés comme faisant plus référence à soi que les mots neutres et si les mots liés au trauma étaient bien notés plus négativement que les mots neutres. Mais aussi, de voir s’il y avait ou pas des différences entre les groupes de personnes et entre les états identitaires.
Résultats
Pour les résultats complets chiffrés et leur étude statistique, n’hésitez pas à aller voir l’article d’origine.
Les résultats les plus importants montrent qu’en ce qui concerne l’intensité du sentiment autobiographique des mots, les personnes TDI donnent une note significativement plus élevée que le groupe « personne saine et personne TSPT ».
Un autre résultat très important est que l’intensité émotionnelle dépend de l’état identitaire chez les personnes TDI : les identités s’identifiant au trauma donnent les notes les plus élevées tous participants confondus.
Cette étude confirme les résultats de précédentes études : le TDI n’est pas le résultat d’un jeu de rôle ou de suggestions. Quand une personne cherche à imiter un TDI, les résultats des tests sont très différents par rapport à ceux des personnes qui ont vraiment le TDI, en particulier pour ce concerne l’intensité de la réaction émotionnelle face à un mot rappelant un traumatisme. On peut aussi voir des différences en terme d’activation des neurones entre les personnes TDI et les personnes simulant un TDI.
L’étude n’a pas fait ressortir de différence significative de résultats entre les groupes d’âge ou entre les groupes de niveau d’éducation. Les différences les plus significatives concernaient les scores de dissociations mesurés avec les outils de mesure de la dissociation. Les personnes avec un TDI avaient des scores de dissociation bien plus élevés que les personnes sans TDI. Les expériences ont montré principalement des différences en fonction des états identitaires et des types de mots qui ont été testés. Ces différences concernent à la fois l’intensité du sentiment autobiographique et la note d’intensité émotionnelle.
Tous les groupes ont bien noté que les mots autobiographiques faisaient référence à soi de façon plus intense que les autres, et que les mots rappelant des traumas étaient plus négatifs que les autres. De plus, il n’y avait pas de grande différence entre les deux sessions – que ça soit au sein d’un même groupe ou en comparant les groupes entre eux.
Ces résultats vont dans le même sens que ceux d’autres études qui ont montré que, suite à un traumatisme, les souvenirs autobiographiques restent cohérents dans le temps. La manière dont ces souvenirs sont traités est similaire chez les personnes avec TDI et les personnes sans traumatisme. D’autres études sur les personnes avec TSPT donnent des résultats similaires : le traitement des souvenirs reste cohérent dans le temps et une thérapie améliore grandement l’état global de la personne. De plus, il n’y a pas de grande différence dans l’évolution du sens de soi dans le temps, que ça soit chez les personnes TDI, les personnes psychotiques ou les personnes saines.
Les précédentes études étaient biaisées, parce qu’elles utilisaient des listes de mots génériques. Or quand on utilise des mots qui ne sont pas spécifiques au vécu de la personne, les gens avec un TSPT ou qui imitent le TDI peuvent donner des résultats équivalents aux personnes ayant vraiment un TDI. La différence se fait dans la spécificité du stimulus par rapport à la personne interrogée. Plus le stimulus est spécifique plus la réaction post-traumatique est viscérale, ce qui montre bien que le TDI n’est pas une simulation, mais un vrai trouble d’origine traumatique. Il y a des vraies différences de fonctionnement entre les identités, en particulier en ce qui concerne les stimuli relatifs aux traumatismes vécus.
Conclusions
L’étude avait pour but d’étudier comment des mots pouvaient être perçus comme relatifs à soi ou chargés d’émotions négatives à travers le temps. Il y avait trois groupes : des personnes diagnostiquées TDI, des personnes saines devant imiter un TDI et des paires de personne avec une personne sans trouble (représentant une identité TDI ne s’identifiant pas au trauma) et une personne avec un TSPT (représentant une identité TDI s’identifiant au trauma).
L’étude confirme donc à quel point le TDI est un trouble complexe, qui modifie les réactions émotionnelles et l’intensité du rapport autobiographique aux souvenirs. L’intensité des réactions est très différentes par rapport aux personnes ayant un simple TSPT. Différentes identités vont avoir des manières différentes de traiter ces informations. De plus, l’appellation « état identitaire neutre » est un peu abusive, car aucun état identitaire ne réagit de manière totalement neutre aux rappels des traumas. Cette étude confirme et enrichit les connaissances et observations cliniques en ce qui concerne la manière dont les personnes dissociées traitent les informations.
La force principale de cette étude est qu’elle utilise des listes de mots qui sont personnalisées. Les sessions étaient suffisamment éloignées dans le temps pour éviter que les participantes les confondent entre elles. L’une des limites de l’étude est qu’elle n’étudie pas toutes les variables qui auraient pu influencer les résultats. Par exemple, seules des femmes ont participé à cette étude ce qui peut biaiser les résultats. Le nombre de participantes était assez petit surtout comparé à des études faites sur d’autres troubles mais de taille moyenne comparé à d’autres études sur le TDI. Certaines études statistiques n’ont pas pu être faites car le nombre de participantes était trop petit.
La manière dont les informations autobiographiques et émotionnelles sont traitées par le cerveau est très différente entre les personnes avec un TDI, le groupe contrôle et des actrices simulant un TDI. Cette différence est constante dans le temps. La manière dont les mots relatifs au trauma sont cotés dépend de l’identité qui réalise cette cotation. Ces conclusions sont en accord avec les observations qui sont faites par les cliniciens.